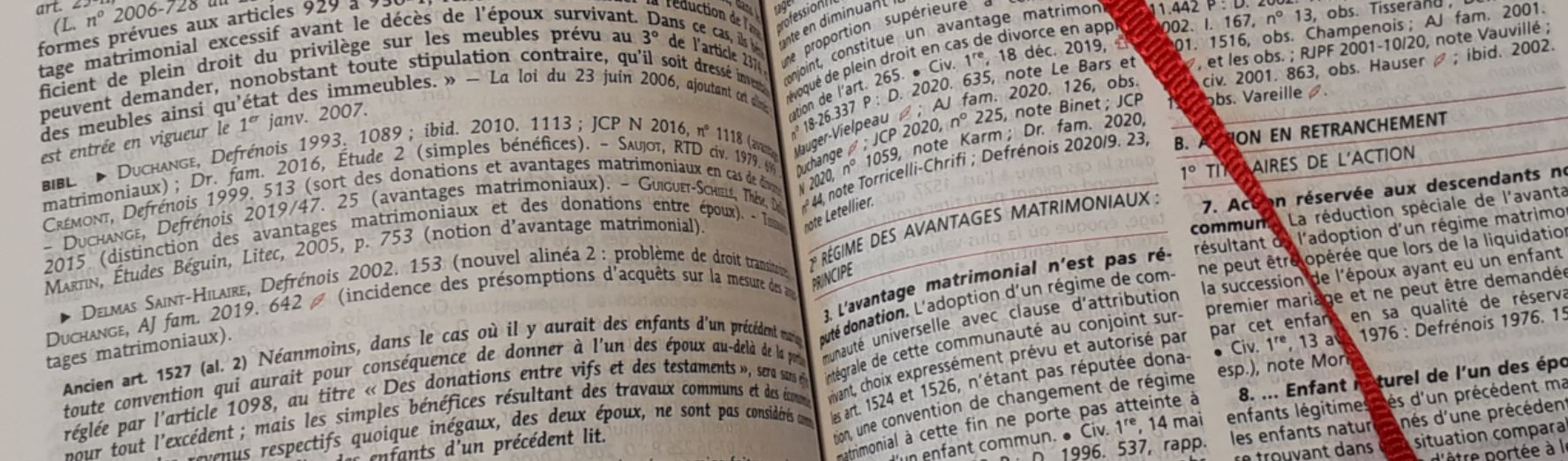La séparation de biens tempérée
Defrénois 14 avril 2023, n° 15, par Nicolas Duchange
Pour tempérer l’individualisme du régime de la séparation de biens, quoi de plus simple qu’un partage des revenus au fil des jours ? Les époux peuvent ainsi bénéficier des avantages d’un régime séparatiste, d’une liberté de gestion à l’abri des créanciers du conjoint, tout en retirant de leur collaboration quotidienne une part ajustée.
Le régime matrimonial qui organiserait un tel partage serait à la fois moins contraignant qu’une communauté, notamment en évitant les embarras de la gestion concurrente ou de la présomption d’acquêts, et plus concret qu’une participation aux acquêts, dont le mécanisme de répartition est différé en fin d’union.[1]
Si cette voie a été peu explorée[2], des évolutions sociétales[3] et juridiques[4] invitent à détailler une formule reposant sur la constitution d’avantages matrimoniaux limités mais immédiats. S’agissant d’une proposition pratique, une présentation sous forme de questions-réponses a été retenue.
Voici les principales questions abordées par cet article, puis ses notes documentaires
A qui s’adresse cette proposition de séparation tempérée ?
[...]
Pourquoi retenir une répartition annuelle des revenus ?
[...]
Quels revenus prendre en considération ?
[...]
Quelle définition et quelle répartition des charges du mariage ?
[...]
Faut-il préciser la notion de « facultés respectives » ?
[...]
Faut-il prévoir une présomption de paiement au jour le jour ?
[...]
Ce contrat est-il proche d’un régime de communauté ?
[...]
Quel fondement juridique retenir ?
[...]
Quelle serait l’incidence des actions en retranchement ou en réduction des avantages matrimoniaux ?
[...]
Pourrait-on prévoir des avantages matrimoniaux complémentaires pour le cas de dissolution par décès ?
[...]
Faut-il prévoir des ajustements en cas d’acquisition d’un outil de travail ?
[...]
Les revenus des époux pourraient-ils être indivis de plein droit ?
[...]
A quel moment la créance de répartition devient-elle exigible ?
[...]
Comment envisager le recouvrement d’une créance de répartition entre époux ?
[...]
Des tiers pourront-ils exercer l’action en paiement d’une dette de répartition ?
[...]
Voici les notes documentaires (non publiées) de cet article
[1] F. Rouvière, Les multiples facettes de la séparation de biens avec société d’acquêts, Defrénois 30 juin 2006, 38413, § 2 : « La raison qui pourrait expliquer la difficulté à promouvoir [le régime de la participation aux acquêts] serait le cloisonnement trop strict entre indépendance et association des intérêts. En d’autres termes, la césure chronologique paraît trop accusée, en ce sens que le régime est séparatiste durant son fonctionnement et associatif au moment de la liquidation. »
[2] Pour une formule limitée s’inspirant de ces considérations, F. Rouvière, art. cit., troisième formule.
[3] Cf. infra, « A qui s’adresse cette proposition ? »
[4] Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337 : JurisData n° 2019-023658 ; très commenté (cf. B. Beignier, Avantages matrimoniaux et participation aux acquêts : nouveaux enseignements, nouvelles pratiques : JCP N 2020, n° 24, 1129, et les références citées), ayant confirmé l’éligibilité d’un régime séparatiste aux avantages matrimoniaux.
[5] En France, cependant que d’autres pays, telle la Belgique, taxent les transmission entre époux, qu’elles résultent de dispositions successorales ou matrimoniales.
[6] Cf. Fanny Lederlin, Travail dit "indépendant" : un inquiétant idéal, Etudes, mai 2021.
[7] D’où la réaction du professeur Séverine Cabrillac, Boule de neige, Defrénois 7 avril 2022, n° 14, DEF206y5 : l’inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes augmente par le jeu du droit patrimonial de la famille, notamment de par « le recul de la communauté légale sous l’effet cumulé de la baisse des mariages et des remariages en séparation. »
[8] Dans une optique différente, N. Couzigou-Suhas, Séparation de biens : convention des futurs époux en matière de contribution aux charges du mariage, Defrénois 21 oct. 2021, n° 43 : « … Les époux conviennent que la contribution aux charges du mariage s’effectuera au moyen de leurs revenus, à l’exclusion des deniers qui seraient qualifiés de propres sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. »
[9] Colomer, Régimes matrimoniaux, Litec 5ème édition 1992, § 183 s.
[10] Terré et Simler, Les régimes matrimoniaux, Dalloz 5ème éd. 2008, n° 51 : « il ne faut pas s’en tenir à l’existence de dépenses nécessaires. Sont aussi des charges du mariage les dépenses ayant pour objet l’agrément de la vie ou l’aménagement de son cadre. »
[11] J. Casey, Les acquisitions immobilières, la contribution aux charges du ménage et les régimes matrimoniaux, AJ fam. 2015, p. 324.
[12] Marion Cottet, La double nature de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, RTD civ. 2021, p. 1.
[13] M. Cottet, art. cit., § 6 : « dans les régimes communautaires, la répartition du passif définitif s’opère sans considération du point de savoir si la dette en cause relève, ou non, des charges du mariage. […] le passif définitif se classe en deux catégories : celles des dettes communes, devant peser à titre définitif sur la masse des biens communs, et celle des dettes propres, devant peser à titre définitif sur l’une des masses de biens propres. L’affectation d’une dette à l’une ou l’autre de ces catégories dépend, pour l’essentiel, du critère du profit retiré. » A. Tisserand-Martin, La contribution aux charges du mariage, mécanisme régulateur du régime matrimonial, Mélanges Champenois, Defrénois 2012, p. 805 : « en régime communautaire, la contribution aux charges du mariage est par excellence une dette commune à titre définitif. »
[14] Une stipulation qui supprimerait toute contribution à la charge d’un époux ne saurait être admise, car portant atteinte à l’existence même d’une obligation impérative associée au mariage.
[15] A. Tisserand-Martin, art. cit., p. 808.
[16] Semble incertaine l’observation selon laquelle « En permettant aux époux d’intervenir sur les fonds relevant de l’exécution de la contribution, on les autorise, indirectement, à délimiter ce qui relève des charges du mariage. » (D. Sadi, Droit de la famille, septembre 2022, n° 9, comm. 126). En effet, on ne peut admettre un ajustement de la délimitation des charges au niveau de la contribution sans se heurter aux conséquences qu’il conviendrait d’en tirer au niveau de l’obligation, vraisemblablement d’ordre public.
[17] 118èmes Congrès des notaires de France, n° 30124 ; Q. Guiguet-Schielé et L. Leroy, Le logement et les couples mariés pendant l’union, DEF 8 septembre 2022, DEF209j0, estimant que la dimension supplétive de l’article 214 du Code civil est surestimée par la pratique notariale et la jurisprudence et attirant l’attention sur le danger d’affaiblir le mariage dans sa dimension institutionnelle.
[18] Considérant que la difficulté majeure est résolue en posant que les dépenses d’investissement doivent être définitivement supportées par les investisseurs. Ce qui correspond à une option très différente de celle souhaitée par J. Casey, art. cit. : « affirmer nettement que le logement de la famille, parce qu’il constitue une dépense nécessaire, vitale et basique pour toute la famille ne peut donner lieu à l’établissement de comptes, sauf cas particulier. » Différence toutefois tempérée par la clause de répartition annuelle des revenus professionnels.
[19] Terré et Simler, op. cit., n° 57, qui évoquent, par analogie avec le droit des sociétés, un apport « en nature », que nous préférons reformuler en apport en jouissance, l’époux propriétaire d’un bien mis à la disposition du ménage en conservant la propriété et pouvant en retrouver la jouissance, par exemple en cas de mise en location d’un bien qui avait servis de logement familial ; J. Casey, art. cit. visant un époux « qui exécute son obligation de contribuer aux charges du mariage en logeant la famille » en mettant un logement propre à la disposition de la communauté.
[20] La distinction entre produits de capitalisation s’accroissant par plus-values et produits de distribution étant souvent artificielle concernant les facultés contributives des époux.
[21] Les commentaires relatifs à la contribution aux charges issues de l’acquisition de la résidence principale présupposent souvent que ce bien aura été acquis par moitié. Or la pratique notariale s’est écartée de ce schéma et tend à ajuster les parts acquises par chacun en fonction d’une anticipation de financement. Financer à deux un bien acquis par moitiés indivises n’a pas la même portée que financer à deux un bien acquis par portions inégales…
[22] Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-21.277 : JurisData n° 2022-009157, D. Sadi, Droit de la famille, septembre 2022, n° 9, comm. 126 : « L’apport de fonds personnels d’un époux en séparation de biens, dans l’acquisition d’un logement de famille indivis ou l’amélioration d’un logement à usage familial indivis, n’est pas un mode de contribution aux charges du mariage. »
[23] Il convient de remarquer que le régime de communauté légale ne fait pas appel à la notion de facultés respectives, s’attachant seulement à distinguer financement propre et financement commun. Or, ce qui semble équilibré dans un régime où la communauté a la jouissance des biens propres pourrait devenir injuste en présence d’une clause conservant propres les revenus des biens propres. Ce qui invite à suggérer que les clauses de cette nature soient complétées par des ajustements concernant la contribution aux charges du mariage.
[24] Cf. A. Tisserand-Martin, art. cit., p. 810, qui souligne qu’une clause qui remplacerait une répartition proportionnelle aux ressources par une répartition mathématique (égalitaire ou non) serait vraisemblablement inopportune, d’une part « du fait qu’il serait extrêmement délicat d’anticiper les conséquences concrètes » lors de la confection du contrat de mariage et, d’autre part, du fait qu’en apportant une illusion de précision, elle favoriserait « les calculs de boutiquiers ».
[25] M. Cottet, art. cit., § 17 : « De fait, l’obligation de contribuer aux charges du mariage est utilisée comme règle de répartition du passif définitif alors même que son domaine s’étend à des prestations non monétaires. […] Il est alors particulièrement délicat d’apprécier les facultés respectives des époux en tenant compte de l’ensemble de ces éléments non monétaires et, corrélativement, de déterminer si un époux a sur-contribué ou sous-contribué aux charges du mariage. »
[26] M. Cottet, art. cit., § 18.
[27] Qui semblent d’ordre public, l’article 2254 du Code civil, permettant des aménagements conventionnels de la prescription, ne visant que les clauses ajoutant aux causes de suspension de la prescription.
[28] 118ème Congrès des notaires, n° 30026.
[29] JCP Ingénierie du patrimoine, V° Avantages matrimoniaux : approche pratique, Fasc. 560, § 7 s. B. Beignier, Qu’est-ce qu’un avantage matrimonial, Mélanges Oppetit, Litec 2010 : « L’avantage matrimonial est la part d’enrichissement, variable, dont bénéficie un époux grâce à l’autre et par la volonté du couple de vivre pleinement la communauté de vie. »
[30] On pourrait théoriquement envisager une clause de répartition des revenus résiduels prévoyant une attribution unilatérale (« … la totalité reviendra à l’époux 1, dépourvu de patrimoine au jour du mariage ») ou inégalitaire, qui déboucherait sur des avantages matrimoniaux retranchables. Une telle clause nous semble inopportune, pouvant difficilement donner lieu à des anticipations claires au jour du contrat.
[31] Ces formules nous semblent insatisfaisantes dans la mesure où elles répondent par une modulation des dépenses à une question concernant directement la répartition des ressources.
[32] En excluant du calcul de la contribution aux charges du mariage « la partie de ces revenus qui viendrait à être affectée au financement de 1'achat, de l’amélioration ou du fonctionnement d’un outil de travail dont l'époux intéressé tire un revenu professionnel. »
[33] Nous proposons cinq ans par analogie avec les dispositions de l’article 1540, al. 2, du Code civil
[34] Jadis la suspension de la prescription entre époux tendait à éviter que, par leur inaction, les époux pussent se servir de la prescription pour se consentir de manière détournée des donations irrévocables contrairement à l'ancienne prohibition de l'article 1096 du Code civil (JurisClasseur Notarial Répertoire V° Prescription - Fasc. 20 Suspension de la prescription, § 28). Ici, l’effet de la clause sera plutôt d’empêcher la création d’un avantage en rendant malaisées les recherches tardives.
[35] G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, 2ème éd. PUF 1977, p. 540.
[36] Civ. 1ère , 26 septembre 2012, Bull. civ. I, n° 143 : « Le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. Dès lors, ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'épouse au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint. »
[37] Par analogie avec les dispositions du premier alinéa de l’article 1479 du Code civil.
[38] L’article 1479 n’étant applicable qu’à défaut de convention contraire, Civ. 1ère, 20 février 1996, D. 1996. Somm. 392, obs. Grimaldi.
[39] Une question de même nature a été posée à l’occasion du remboursement par un ex-époux, pendant l’indivision post-communautaire, du solde du crédit immobilier souscrit en cours d’union : sa créance sur l’indivision devait-elle être calculée en fonction de la valeur du bien financé au jour du début de l’amortissement de cet emprunt ou de la valeur au jour de la naissance de l’indivision par dissolution du mariage ? La Cour de cassation a cru devoir retenir le jour du début de l’amortissement, faisant ainsi bénéficier l’ex-époux d’une forte revalorisation de la dépense faite alors que l’indivision aura duré peu de temps ! Cass. 1ère civ.,1er février 2017, n° 16-11599, Defrénois 2018, n° 12, 134k4, note G. Champenois et I. Dauriac, spéc. p. 19, qui admet, à notre sens de manière également contestable, d’étendre cette solution concernant un bien acquis avant mariage mais dont le crédit aura été soldé en cours d’union, en proposant de retenir la valeur initiale du bien et non la valeur au jour du mariage.
[40] L’indexation « sur la variation moyenne de l’indice général des prix à la consommation des Etats contractants » a été retenue par le régime franco-allemand optionnel de la participation aux acquêts, art. 9.
[41] Cf. J. Casey, art. cit., évoquant « un masque traditionnel, accepté, mais un masque tout de même. »